À première vue, la musique viking ressemble à un fantôme. Elle ne laisse presque rien derrière elle. Quelques fragments d’os percés, des morceaux de bois sculpté, des lignes acides dans des chroniques étrangères… et le grand silence des siècles. Pourtant, derrière ce silence apparent, tout indique que les Scandinaves de l’Âge viking vivaient dans un monde plein de sons, de voix et de rythmes.
Chez eux, la vraie star, c’est la poésie. Les scaldes composent, mémorisent, déclament devant des salles entières suspendues à leurs lèvres. Odin lui-même n’est pas dieu de la musique, mais maître de la parole sacrée. La musique, elle, se glisse partout ailleurs. Elle accompagne les mots, les gestes, les voyages, les sacrifices, les veillées, les jeux d’enfants. Elle n’a pas de trône, mais elle a le terrain.
Les sources sont avares. Nous ne possédons presque aucune partition musicale de cette époque. Pas de “tube viking” à passer sur Spotify. En revanche, nous avons des indices, des cousins, des héritages : mélodies islandaises, chants de travail, polyphonies venues de l’Est, traditions samies, échos byzantins. En les croisant, les chercheurs tentent de recomposer un paysage sonore et musical plausible. Non pas “la musique viking” figée une fois pour toutes, mais un monde de musiques en mouvement.
Dans cet article, nous allons explorer la musique et ses instruments à l’Âge des Vikings. Nous suivrons les voix des marins, des guerriers, des scaldes, des femmes qui appellent leurs troupeaux et des mères qui bercent leurs enfants. Nous suivrons aussi le fil des instruments vikings. Enfin, nous verrons comment, aujourd’hui, musiciens et passionnés tentent de redonner chair à ces sons perdus, entre reconstitution historique et néo-folk envoûtant.
Peut-on parler de « musique viking » ? Sources et limites
Parler de musique viking, c’est un peu comme vouloir saisir de la fumée avec les doigts. Elle existait, c’est certain. Elle accompagnait les gestes, les fêtes, les rites. Mais elle nous échappe dès qu’on croit tenir un fragment. La faute à une culture où la poésie dominait tout. Les Scandinaves vivaient dans un monde gouverné par la parole. Le verbe sculptait la mémoire, les sagas, la gloire. La musique, elle, passait derrière. Elle soutenait, elle soulignait, elle vibrait dans l’ombre du texte.
Chihiro Tsukamoto, spécialiste du vieux norrois, l’explique clairement. Pour les Vikings, l’art suprême n’était pas la mélodie mais la strophe. Dans la mythologie nordique, Odin n’était pas un Apollon nordique. Il régnait sur les mots, pas sur les notes. Résultat : la musique ne bénéficia pas du même prestige. Pas de divinité protectrice. Pas de tradition savante consignée après coup. Et presque aucune trace écrite avant la christianisation.
Les sources musicales sont donc minces. Elles se cachent dans les chroniques arabes où des voyageurs décrivent des chants rauques, comparés à des chiens ou à des loups. Dans quelques récits islandais qui parlent de cris de guerre, d’appels, de lamentations. Dans les témoignages des missionnaires qui ne comprennent pas ce tumulte venu du Nord. Et dans l’archéologie, patiente et obstinée, qui déterre des flûtes, des fragments de lyres, des cornes et des hochets.
Après l’an mille, tout se clarifie. Le christianisme s’impose. La liturgie structure la musique. Les manuscrits apparaissent. Les influences byzantines, slaves, celtiques et germaniques se mêlent. On voit enfin émerger des partitions, des descriptions précises, des hymnes dans la culture nordique. Mais pour la période païenne, il faut recomposer le tableau avec ce qu’on a : des morceaux épars, des parallèles avec d’autres traditions, des survivances dans le folk scandinave et les chants samis.
Au fond, la vraie question n’est plus : « Les Vikings avaient-ils une musique ? ». Évidemment qu’ils en avaient une. La question est : « Comment la retrouver sans la trahir ? ». Et c’est ce que tentent de faire archéologues, musicologues et passionnés, en écoutant ce que les objets, les textes, les voix et les traditions voisines murmurent encore.

Les voix du Nord : les grands types de chants à l’Âge viking
Avant même de parler d’instruments de musique, il faut prêter l’oreille aux voix du Nord, car c’est par le chant que les hommes du Nord donnaient forme au rythme de leur vie.
Le chant comme outil du quotidien
Avant d’être un art, le chant est un outil. À l’époque viking, une voix qui s’élève sert d’abord à faire quelque chose. Mémoriser un récit. Coordonner un geste. Calmer un enfant. Encourager un équipage dans la bruine. Dans cette perspective, la frontière entre chant, parole rythmée et poésie disparaît presque.
La théorie du « musilangage », proposée par le musicologue Steven Brown, va dans ce sens. Le chant, très tôt, aurait permis d’allier rythme, émotion et unités de langage. Chez les Scandinaves, baignés dans la tradition orale, cette fonction est évidente. Quand la poésie scaldique bâtit les grandes sagas, le chant prolonge ce pouvoir des mots dans le corps et dans la voix.
On peut imaginer les Vikings chantant pour :
- Rythmer le travail collectif sur un navire ou dans un champ.
- Se souvenir d’un itinéraire, d’un exploit, d’un danger.
- Souder un groupe avant la bataille ou après un deuil.
- Apaiser un enfant, une bête, un cœur trop agité.

Les chants de marins : donner du rythme à la mer
Les Vikings sont des gens de bateaux. Longues traversées en haute mer, remontées de fleuves, halage sur la grève. Tout cela demande du souffle, du muscle et une cadence commune. Le chant devient alors un métronome vivant.
On peut imaginer des chants de guerriers vikings :
- Pour hisser les voiles au même moment.
- Pour virer ou pomper l’eau de mer hors du navire.
- Pour nager à l’aviron, tous ensemble, sans casser le rythme.
- Pour déhaler le bateau, tiré à la corde sur la terre ferme.
Entre deux manœuvres, la voix peut aussi détendre l’équipage. Raconter une histoire. Moquer un voisin. Rappeler une femme laissée au pays. Dans une flotte, certains airs servent peut-être de signe de reconnaissance. Un motif mélodique qui dit: « Ceux-là, ce sont les nôtres. »
Les chants de guerre : hurler avec les dieux
Les ancêtres germains des Vikings étaient déjà célèbres pour leurs chants de guerre. Tacite, sénateur et historien romain décrit un « bardit » où les guerriers serrent leurs boucliers contre la bouche pour amplifier le son. Les voix deviennent un grondement. Les mots se dissolvent dans le fracas.
À l’Âge viking, cette tradition ne disparaît pas. Au contraire, elle se charge de mythologie. Chanter, c’est marcher côte à côte avec les dieux et les Valkyries. On exhorte les hommes à oublier la peur, à courir vers le bouclier plutôt que vers la fuite. On rend hommage aux morts et on promet leur mémoire aux poèmes futurs.
Le « Chant des Valkyries » conservé dans la Saga de Njáll montre bien cette atmosphère. Des Nornes, tisseuses du destin, debout devant un métier à tisser fait de boyaux humains et de têtes coupées, chantent l’issue sanglante d’une bataille. La musique n’y est pas notée. Mais le texte laisse entendre un rythme lourd, martelé, martial.
Les chants de travail : labourer, moudre, tisser en cadence
Sur la terre ferme, la vie viking n’a rien de romantique. Labour, semailles, récoltes, mouture, tissage, corvées sans fin. Le chant vient boucher les trous de la fatigue. Il berce les gestes. Il fait passer le temps plus vite.
Souvent, celui qui a la voix la plus forte lance la strophe. Les autres reprennent le refrain. Les paroles ne sont pas figées. On improvise une taquinerie, une plainte, un souvenir. Certains historiens voient dans la « Chanson de Grótti » un écho de ce type de chant de travail. Deux esclaves, Fenja et Menja, tournent la meule et chantent leur histoire, leur lassitude et la vengeance qui vient.
Dans les pâturages, la voix prend un autre rôle. Les appels aigus, proches du futur lokk scandinave (dont nous parlons plus bas), servent à rassembler les troupeaux. Avant la flûte, avant le lur, ce sont ces cris mélodiques qui portent le plus loin dans l’air froid.

Les chants cérémoniels : accompagner les passages
La musique n’est jamais très loin des rites. Funérailles, mariages, naissances, sacrifices: chaque seuil appelle des sons particuliers. Les textes parlent rarement de mélodies. Mais ils évoquent des chants, des cris, des voix qui montent avec la fumée.
Le récit d’Ibn Fadlan sur les funérailles d’un chef rus’ en est un exemple brutal. Une esclave, enivrée, chante avant d’être sacrifiée pour accompagner son maître dans l’autre monde. Les hommes frappent sur leurs boucliers pour couvrir ses cris. On ne sait pas si cela formait une musique au sens strict. On comprend en revanche que le son, le rythme, le choc des coups faisaient partie intégrante du rituel.
Lors des assemblées politiques comme le Thing, ou dans les grandes salles des rois, la musique et la poésie se mêlent. On déclame, on chante, on écoute des récits héroïques. Les voix scellent des alliances autant que les serments jurés sur les anneaux sacrés.
Les chants scaldiques : la mémoire vivante des puissants
Avec les scaldes, on passe de la rumeur collective à l’art maîtrisé. Le Skáldatal, catalogue de poètes attribué à Snorri Sturluson, aligne plus de deux cents noms. Ce sont les voix professionnelles du Nord. Elles suivent les rois, les jarls, les chefs de guerre. Elles transforment leurs actes en vers ciselés.
Leurs compositions obéissent à des règles strictes. Les drápa et les flokkar enchaînent les strophes, les images, les kennings. D’autres formes, plus libres ou plus brèves, jaillissent à l’occasion d’une insulte, d’une joute verbale, d’un amour interdit. Certaines sont des chants d’amour, d’autres des satires qui peuvent coûter l’exil à leur auteur.
Était-ce chanté ou simplement déclamé sur un ton scandé. Probablement les deux, selon le contexte. Dans une halle enfumée, devant un seigneur entouré de sa suite, la frontière entre récitation rythmée et chant se brouille. La voix porte, se module, s’appuie sur une lyre ou se suffit à elle-même. Là encore, la musique est indissociable de la parole.
Les chants de l’enfance : berceuses, comptines et jeux
Même chez les Vikings, il faut bien endormir les enfants. Le genre le plus ancien et le plus universel reste la berceuse. On n’en possède aucune version notée pour l’Âge viking. Mais les berceuses du folk nordique donnent quelques pistes.
La voix se fait grave, régulière. La mélodie tient sur deux ou trois notes. On parle de la maison, des animaux, des parents, de ce qui rassure. Il ne s’agit pas de briller, mais d’apaiser. Le balancement du chant accompagne le balancement du corps.
Plus tard, viennent les comptines et les chansons de jeux. On chante pour se lancer une balle, tourner en ronde, se moquer gentiment d’un camarade. Dans ces petites formes, la musique apprend aux enfants les codes de leur communauté. Ce ne sont pas de grandes sagas. Ce sont des graines de mémoire.

Échos anciens : chants nordiques et traditions cousines
Bien avant que les instruments de musique ne prennent le relais, les peuples du Nord tissaient déjà un vaste paysage sonore, où chaque région portait sa propre manière d’appeler, de chanter et de communiquer.
Le lokk : l’appel scandinave venu des montagnes
Quand l’été pousse humains et troupeaux vers les alpages, un autre chant se met en marche. Le lokk – ou kulning en Suède – résonne de vallée en vallée. C’est un appel. Une voix aiguë, tendue, qui file droit dans l’air froid. Une note longue, presque irréelle, puis une descente d’un demi-ton ou d’un quart de ton. Les troupeaux reconnaissent cet appel comme une signature.
Ces chants, presque exclusivement portés par les femmes et les enfants, servaient à rassembler les vaches, les chèvres ou les moutons éparpillés dans les pentes. Chaque chanteuse, chaque fermière, avait sa manière d’enchaîner les notes. Mais toutes partageaient un langage commun, fait de signaux à distance et d’intonations codées.
Cette technique vocale, considérée par certains chercheurs comme l’une des plus anciennes formes musicales du monde, précède l’usage des instruments pour communiquer. Elle montre que la voix humaine, chez les peuples du Nord, n’était pas seulement porteuse d’émotion : elle guidait, commandait, rassemblait, et parfois faisait taire la solitude des montagnes.
Le joik sami : chanter l’être plutôt que les mots
Plus au nord encore, dans les territoires samis, vit un chant qui fascine depuis des siècles : le joik. À la différence des chants vikings décrits dans les sagas ou par les chroniqueurs étrangers, le joik n’essaie pas de raconter ou de décrire. Il est son sujet.
On joike un paysage, un animal, un ancêtre, une émotion. Pas pour le décrire, mais pour le faire exister à travers la voix. Le chant est souvent a cappella, construit sur des notes glissées, pentatoniques, sans début ni fin. Il ressemble à une boucle vivante. Une évocation immédiate, presque chamanique.
Les Vikings ont côtoyé les Samis. Des échanges commerciaux, des alliances, parfois des tensions. Mais dans toutes ces rencontres, les influences circulaient. Le joik, pratiqué par les noaidis (chamanes sames), a été combattu par les missionnaires, réprimé, interdit. Il a pourtant survécu, transmis en secret de génération en génération. Aujourd’hui encore, il porte une dimension spirituelle que beaucoup associent volontiers à l’atmosphère “viking”, même si ses racines sont beaucoup plus anciennes.
Le chant de gorge inuit : le souffle comme instrument
Dans l’Arctique, les femmes inuites pratiquent un chant si particulier qu’il semble à la frontière du jeu, du duel et du rituel. Le chant de gorge – katajjaq ou lirngaaq selon les régions – se chante généralement en duo. Deux femmes se font face, se répondent, s’imposent un rythme de respiration presque acrobatique.
Ce ne sont pas des mélodies au sens classique. Ce sont des boucles, des grognements, des souffles syncopés. Le jeu s’arrête quand l’une rit ou s’essouffle. Et, par un étrange écho, certains chroniqueurs étrangers, notamment l’Andalou Ibrahim ibn Ya’qub, ont comparé les chants entendus à Hedeby à des sons de gorge “sauvages”, proches des chiens ou des loups. Peut-être un malentendu. Peut-être un lien ténu. Mais ces descriptions donnent une idée de la rugosité et de la puissance des voix du Nord.
Le leelo seto : la polyphonie aux portes de la Baltique
Dans le sud-est de l’Estonie, le peuple seto perpétue un chant appelé leelo. Sa structure, fondée sur l’alternance d’un soliste et d’un chœur polyphonique, intrigue les historiens. Le soliste mène, rapide et souple. Le chœur reprend, plus lent, plus large, souvent à deux ou trois voix.
Cette forme d’hétérophonie pourrait remonter à plus d’un millénaire. Elle a accompagné le travail, les fêtes, les rites saisonniers, les mariages, les veillées. Le timbre particulier, parfois aigu et percutant, résonne d’un archaïsme qui pourrait être contemporain de l’Âge viking. Rien ne permet d’affirmer une transmission directe. Mais l’environnement musical de la Baltique était riche, mouvant, interconnecté. Les Vikings n’étaient pas seuls dans leur monde sonore.
Le dvouglas bulgare : bourdon, vibrato et puissance collective
Plus au sud, en Bulgarie, un autre type de chant polyphonique témoigne d’une très ancienne tradition : le dvouglas. Les chanteuses – souvent des femmes âgées, gardiennes de cette mémoire – mêlent un bourdon continu, des mélodies syncopées, des vibratos serrés. Le résultat est hypnotique.
Ces chants accompagnaient les travaux agricoles, les fêtes, les rituels d’initiation et même les funérailles. Ils montrent qu’en Europe de l’Est, la voix collective sculptait des paysages sonores d’une grande intensité. Les Vikings, qui commerçaient jusqu’aux confins de la Mer Noire, n’étaient pas isolés de ces influences.
Le chant byzantin : une présence au carrefour des mondes
Les Varègues – ces Scandinaves qui servaient à Constantinople dans la garde impériale – se trouvaient au cœur de l’une des plus prestigieuses traditions musicales médiévales : le chant byzantin. Monophonique, mais d’une richesse modale immense, il repose sur huit tons et une articulation très particulière du texte liturgique.
Ce chant, transmis oralement par les psaltes, a traversé les siècles. À l’époque viking, il baignait les rues de Miklagarðr. Les Scandinaves qui y vivaient, y combattaient, y commerçaient, ont forcément entendu ces voix monter des églises orientales. Les influences ne sont pas documentées, mais le simple fait de cette proximité élargit le paysage sonore dans lequel évoluaient les Vikings.
Un monde de sons, pas une seule “musique viking”
Ce panorama montre qu’il n’existait pas une musique nordique figée, mais une mosaïque vivante. Des voix qui appellent, qui racontent, qui chuchotent, qui rassemblent. Des traditions voisines qui amplifient, complètent ou contrastent avec les pratiques scandinaves. Un univers sonore riche, mouvant, nourri par les voyages et les contacts.
Avant d’étudier les instruments, il faut garder en tête cette évidence : la musique viking, c’est d’abord la voix. Une voix ancrée dans un monde où l’on vit, travaille, prie et se bat en rythme.

Les instruments de musique à l’Âge viking
Après les voix, viennent les objets. Les instruments retrouvés par les archéologues complètent le tableau sonore des Vikings. Certains sont simples, taillés dans l’os ou le bois. D’autres sont plus élaborés, sculptés avec soin. Tous racontent un monde où la musique accompagne le quotidien, la guerre, les fêtes et les rituels.
Les instruments à vent : souffle, signal et mélodie
Les flûtes en os et en bois
Les flûtes sont parmi les instruments à vent les plus courants retrouvés sur les sites scandinaves. Fabriquées dans des branches de bois de sureau, de saule ou dans des os de vache, de cerf ou de grands oiseaux, ces flûtes offrent une grande variété de formes.
- Flûtes sans trous, utilisées pour imiter des cris d’animaux.
- Flûtes à 1 ou 2 trous, très simples.
- Flûtes à bec, parfois jusqu’à 7 trous, capables de jouer de véritables mélodies.
Certaines découvertes, comme celles de Birka, montrent que ces instruments pouvaient être utilisés autant pour la musique que pour la chasse ou la communication. Les répliques modernes donnent un son clair, parfois surprenant de finesse.
La flûte de pan de Coppergate
Lors des fouilles de Coppergate à York, une flûte de pan taillée dans du buis a été mise au jour. Compacte, creusée de cinq à huit tubes, elle montre que les Vikings maitrisaient aussi des instruments plus complexes, capables d’une gamme variée.
Le hautbois de Falster
Une découverte intrigante est celle d’un tuyau en bois percé de cinq trous, retrouvé sur l’île de Falster au Danemark. Son embouchure manquante empêche de l’identifier avec certitude. Deux hypothèses dominent :
- Un chalumeau appartenant à une cornemuse primitive.
- Un instrument à anche double, un ancêtre du hautbois.
Des instruments similaires ont été retrouvés en Suède et aux Pays-Bas, ce qui renforce la piste du hautbois scandinave.
Les olifants et cornes à jouer
Les cornes animales sont omniprésentes. Certaines ne produisent qu’une seule note : les olifants. D’autres, percées de trous, deviennent de véritables instruments mélodiques.
Une corne du IXe siècle retrouvée à Västerby possède quatre trous et une embouchure sculptée. Elle a probablement servi à la fois pour la musique et les signaux.
Le lur : la voix longue du Nord
Le lur est l’un des instruments les plus emblématiques. Longue trompe en bois, parfois dépassant le mètre, elle servait aux bergers pour rassembler le bétail. Mais elle possédait aussi une fonction guerrière.
Son apparition dans les sagas, notamment celle d’Olaf Tryggvason, témoigne de son usage lors des batailles. Le son du lur est grave, puissant, capable de traverser une vallée entière.
La guimbarde
Petite, économique, rudimentaire, la guimbarde traverse toutes les cultures depuis des millénaires. Les exemplaires retrouvés en Scandinavie datent souvent du XIIIe siècle, mais certains archéologues pensent que cet instrument était déjà connu à l’Âge viking.

Les instruments à cordes : lyres, harpes et vièles
La lyre, instrument du skald
Si un instrument à cordes incarne l’univers viking, c’est la lyre. La lyre anglo-saxonne de Sutton Hoo en est le modèle le mieux conservé, mais des fragments trouvés en Scandinavie montrent que ce type d’instrument était courant.
Des ponts de lyre en ambre (Gotland) et en corne (Birka) indiquent des instruments soignés, parfois luxueux. La lyre accompagnait sans doute la poésie scaldique, les récitations, les rassemblements festifs.
Le paradoxe de Gunnar et de sa “harpe”
Dans la saga des Völsungs, Gunnar charme des serpents avec une “harpe”. Les sculptures médiévales inspirées de cette scène montrent pourtant une lyre. Ce détail souligne les flottements terminologiques entre ces instruments à cordes comme la harpe, la lyre et la vièle dans les textes.
Talharpa, jouhikko et crwth : les lyres à archet
La talharpa (ou tagelharpa), la lyre à archet du Nord, apparaît surtout à partir du Moyen Âge tardif. Les Vikings n’en ont laissé aucune trace archéologique directe, mais elle pourrait dériver d’instruments plus anciens.
Ses cousines :
- Le jouhikko finlandais, attesté dès le XIVe siècle.
- Le crwth gallois, utilisé au Moyen Âge.
Le son de ces instruments, frotté et profond, est aujourd’hui très présent dans la musique viking contemporaine.
Le rebec de Hedeby
À Hedeby, une grande place marchande viking, des fragments d’un rebec ont été trouvés. Cet instrument, venu du monde arabe par l’intermédiaire de l’Europe, témoigne des vastes échanges culturels de l’époque.
La vièle, le gigje et la moraharpa
Ces instruments à archet, mentionnés dans les textes, n’ont laissé aucune trace archéologique datable de l’Âge viking. On sait que la vièle existait en Europe, que le gigje est mentionné dans les sources nordiques, et que la moraharpa du XVIe siècle pourrait être leur descendante indirecte.
Une possible cithare à Nidaros ?
Une sculpture de la cathédrale de Nidaros représente un musicien jouant un instrument rectangulaire à cordes. Certains y voient une cithare, ancêtre de la langeleik. Mais aucune preuve archéologique ne permet d’en confirmer l’existence à l’Âge viking.

Les percussions et instruments rythmiques
Le tambour : l’absent omniprésent
Aucun tambour de l’Âge viking n’a survécu aux siècles. Le bois, la peau et les fibres animales des tambours se dégradent trop vite pour traverser le temps. Pourtant, il serait surprenant qu’un peuple aussi imprégné de rituels, de fêtes et de pratiques sonores n’ait pas utilisé de percussions. Les textes arabes, notamment Ibn Fadlan, évoquent des boucliers frappés lors de cérémonies funéraires, comme si les Scandinaves transformaient leurs armes en tambours improvisés pour couvrir les cris ou exalter le courage.
Mais ce silence archéologique ne dit pas tout. Les Vikings côtoyaient les Samis, leurs voisins du Nord, dont les tambours chamaniques — appelés goavddis ou gievrie — sont parfaitement attestés. Peaux de renne tendues, symboles cosmiques peints, rythmes utilisés pour la transe ou la communication spirituelle : ces instruments faisaient partie intégrante des pratiques des noaidis, les chamanes traditionnels.
Les Scandinaves connaissaient ces peuples, commerçaient avec eux, partageaient parfois les mêmes territoires de chasse. Il est donc très plausible qu’ils aient entendu ces tambours, peut-être même intégré certains de leurs usages dans des contextes rituels. Sans preuve directe, il est impossible d’affirmer que les Vikings possédaient leurs propres tambours chamaniques — mais il serait tout aussi imprudent d’exclure cette possibilité.
En définitive, le tambour reste le grand absent des fouilles, mais un absent qui résonne. L’écho des pratiques samies, les scènes décrites par les chroniqueurs et l’universalité de la percussion laissent entrevoir un instrument discret, mais essentiel, probablement utilisé lors des fêtes, des rassemblements, des rites ou des moments solennels.
Les hochets : objets sonores multipliés
Plusieurs hochets en fer ont été retrouvés, notamment dans le bateau d’Oseberg. Ils servaient peut-être d’objets rituels, de clochettes pour les traîneaux ou de simples instruments rythmiques.
Les exemplaires de Stövernhaugen, munis d’anneaux de fer attachés à une longue perche, montrent que le tintement faisait partie intégrante de certaines cérémonies ou activités.
Ces instruments, qu’ils soient en os, en bois, en corne ou en métal, dessinent un paysage musical discret mais omniprésent. Le monde viking n’était pas silencieux. Il respirait, il grondait, il chantait, il vibrait.
Reconstituer la musique de l’Âge viking
La grande difficulté pour comprendre la musique viking tient dans le fait qu’elle n’a presque laissé aucune trace écrite. Pas de partitions, peu d’instruments complets, et une oralité qui a disparu avec ceux qui la portaient. Pourtant, chercheurs, musiciens et folkloristes ont rassemblé un ensemble d’indices précieux. À partir de fragments, de traditions voisines et de manuscrits plus tardifs, ils tentent de reconstituer l’univers sonore de l’Âge viking.
Les rares partitions médiévales liées au Nord
Le Codex Runicus et “Drømde mik en drøm i nat”
L’une des plus anciennes partitions de Scandinavie se trouve dans le Codex Runicus, un manuscrit du XIVe siècle entièrement écrit en runes. La dernière page contient les deux premiers vers de la chanson danoise Drømde mik en drøm i nat.
Cette notation reste postérieure à l’Âge viking, mais elle montre comment la musique populaire scandinave commençait à être consignée après la christianisation. Les lignes mélodiques simples, répétitives, pourraient refléter des traditions plus anciennes.
L’hymne à Saint Magnus : un héritage nordique
Nobilis, humilis, un hymne du XIIe siècle, provient de l’archipel des Orcades, autrefois sous domination norvégienne. Cet hymne présente une forme primitive de polyphonie appelée gymel, fondée sur des intervalles parallèles.
Le chroniqueur Giraldus Cambrensis décrit au XIIe siècle une tradition de chant polyphonique dans le nord de la Grande-Bretagne, qu’il attribue aux influences scandinaves. Ces témoignages confortent l’idée que les peuples nordiques pratiquaient des formes de polyphonie bien avant leur mise par écrit.
L’Islande : un laboratoire musical préservé
Isolée géographiquement, l’Islande a conservé une langue proche du vieux norrois et des traditions musicales singulières. Ce qui ne signifie pas qu’il s’agit d’un miroir fidèle de la musique viking, mais ces survivances donnent des indications précieuses.
Cinq chansons en vieux norrois
Jean-Benjamin De la Borde, dans son Essai sur la Musique Ancienne et Moderne (1780), consigne cinq mélodies chantées en Islande, associées à des textes en vieux norrois. Parmi elles, on retrouve des extraits de la Völuspá, du Hávamál ou encore du Krakamál.
Toutes présentent une structure mélodique souple, construite autour de la tierce majeure, capable de s’adapter à différentes longueurs de vers. Cette flexibilité pourrait remonter à des pratiques très anciennes.
Le chant du roi Harald Hardrada
L’une des mélodies recensées par De la Borde reprend un chant associé au roi norvégien Harald Hardrada. Elle ne commence ni ne se termine sur la tonique, mais sur la tierce, suggérant un enchaînement de voix parallèles.
Ce type de construction rappelle certaines formes primitives de polyphonie et renforce l’idée que les Nordiques jouaient avec des intervalles inhabituels pour le reste de l’Europe médiévale.
Le “Lilja” et l’influence orientale
Une autre mélodie, Lilja, se distingue des précédentes par l’utilisation de tierces mineures et de phrasés proches des musiques byzantines et moyen-orientales. Un indice supplémentaire d’un monde musical nordique ouvert aux influences extérieures.
Rímur et tvísöngur : survivances vocales islandaises
Les rímur sont des poèmes chantés datant, pour les plus anciens, du XIVe siècle. Les textes sont saturés de figures scaldique : kennings, heiti, allitérations.
Les tvísöngur, quant à eux, sont des chants en quintes parallèles, héritiers de formes primitives d’organum médiéval. Leur rigidité, leur résistance au changement et leur archaïsme apparent pourraient refléter des pratiques vocales très anciennes.
Pour Chihiro Tsukamoto, ces traditions ne doivent pas être vues comme des fossiles intacts de l’Âge viking, mais comme des sources d’inspiration structurantes pour approcher les formes musicales disparues.
Les défis de la reconstitution
L’absence de notations anciennes, la disparition des instruments et la transformation des traditions rendent la reconstitution difficile. À cela s’ajoute la suppression active de la musique païenne par l’Église après la conversion au christianisme.
La musicologue Tsukamoto insiste : il est vain de parler d’une “musique nordique ancienne” comme d’un bloc homogène. Le paysage sonore viking était mouvant, influencé par les échanges avec l’Orient, l’Europe continentale, les Samis, les peuples baltiques.
La seule vraie question est : non pas “est-ce possible ?” mais “comment l’étudier ?”.
Les reconstitutions modernes
La tentative la plus structurée reste la collaboration Viking Tone (Erik Axel Wessberg, Mogens Friis, Knud Albert Jepsen), qui propose des interprétations d’airs anciens danois et islandais avec des instruments reconstruits à partir des fouilles archéologiques.
D’autres groupes s’inspirent librement des traditions vocales et instrumentales du Nord pour recréer des ambiances “vikings” plausibles. Ils s’appuient sur le son des lyres, des lurs, de la guimbarde, mais aussi sur les structures vocales du joik ou les polyphonies baltiques.
Ces reconstitutions ne prétendent pas être des copies parfaites. Elles ouvrent un espace où l’on peut écouter ce que les Vikings ont peut-être entendu.
La musique viking contemporaine : héritages, renaissances et réinventions
Si la musique de l’Âge viking n’a pas survécu intacte, son esprit continue pourtant de traverser les siècles. Depuis le XXe siècle, des musiciens, des compositeurs et des groupes néofolk ont réinterprété l’atmosphère sonore du Nord. Ils s’appuient sur les découvertes archéologiques, les traditions scandinaves et les ressources ethnomusicologiques pour recréer une musique qui fait vibrer quelque chose de profondément ancien.
Le néofolk nordique : entre authenticité et imaginaire
Le mouvement néofolk qui puise dans les traditions scandinaves s’est imposé comme la porte d’entrée moderne vers l’univers musical viking. Le groupe phare de cette mouvance est Wardruna. Fondé par Einar Selvik, l’ensemble s’est spécialisé dans l’utilisation d’instruments reconstitués :
- lyres à six cordes,
- lurs en bois ou en corne,
- tagelharpas,
- tambours chamaniques samis,
- cornes à jouer,
- flûtes d’os.
Wardruna n’imite pas la musique viking. Le groupe la réinvente, en intégrant des modes anciens, des structures répétitives, des chants d’évocation et une spiritualité païenne qui enflamme l’imaginaire.
Danheim : le souffle tribal de la musique viking moderne
Danheim, de son côté, propose une approche plus martiale et cinématographique, mêlant percussions lourdes, chants profonds, atmosphères sombres et structures pulsées qui rappellent autant les rituels anciens que les bandes-annonces modernes. Là où Wardruna privilégie l’introspection et la spiritualité runique, Danheim explore l’énergie brute des mythes, des batailles et des paysages nordiques.
Heilung : la transe rituelle moderne
Autre formation emblématique : Heilung. Très théâtral, ce collectif mêle :
- percussions archaïques puissantes,
- chant guttural,
- voix féminines inspirées du joik,
- instruments reconstitués,
- textes issus des inscriptions runiques et des sagas.
Leurs concerts musicaux s’apparentent à des rituels tribaux, où le passé, le présent et le mythe s’entremêlent.
Skáld : l’accessibilité poétique
Le groupe Skáld propose une approche plus accessible, centrée sur la poésie nordique — notamment les textes de l’Edda Poétique — qu’il met en musique avec des instruments reconstitués. Leur travail a contribué à populariser l’esthétique “viking” auprès du grand public.
Le “Viking Metal” : héritage amplifié
La mythologie nordique irrigue aussi la scène metal depuis les années 1990. Certains groupes ont fait de cet héritage un véritable sous-genre : le Viking Metal.
Parmi les plus influents :
- Bathory — pionniers du genre, avec des albums inspirés des sagas.
- Amon Amarth — dont les textes évoquent Thor, Odin, Ragnarök.
- Tyr — groupe des Îles Féroé, mêlant folklore et metal progressif.
Ici, les instruments sont modernes, mais les thèmes, les rythmes martiaux et certaines vocalises peuvent rappeler la puissance et la rudesse décrites par les chroniqueurs médiévaux.
Un héritage sonore multipiste
Aujourd’hui, l’inspiration “viking” dépasse largement le néofolk ou le metal. Elle infuse une multitude de genres musicaux modernes, chacun y puisant une part de son atmosphère, de ses rythmes ou de son imaginaire.
- Musique classique néo-nordique : Jón Leifs, Einar Selvik & Ivar Bjørnson (Skuggsjá), Geirr Tveitt et Bent Sørensen développent des œuvres orchestrales inspirées des sagas et des paysages scandinaves.
- Jazz scandinave : Jan Garbarek, l’Esbjörn Svensson Trio (E.S.T.), Nils Petter Molvær ou Trygve Seim créent un jazz aérien et brumeux, nourri par les modes et les ambiances du Nord.
- Ambiances cinématographiques : les musiques de Vikings, The Last Kingdom, The Northman, God of War ou Assassin’s Creed Valhalla utilisent percussions tribales, lurs, chants gutturaux et textures inspirées des instruments antiques.
- Musiques électroniques atmosphériques : Lustmord, Ulf Söderberg (Sephiroth) ou Solar Fields mêlent dark ambient, rituels sonores et influences nordiques pour créer des paysages sonores immersifs.
Cette diversité montre une réalité simple : même si la musique originelle de l’Âge viking s’est perdue, son imaginaire demeure une source intarissable, souple et créative, qui continue d’inspirer des artistes de tous horizons.
Entre archéologie et imaginaire contemporain
Les reconstituteurs, les artisans luthiers, les ethnomusicologues et les artistes travaillent souvent ensemble pour reconstruire des instruments viking crédibles. Certains projets fouillent jusqu’aux mortiers, aux gravures, aux fibres végétales, aux pigments.
Le résultat n’est jamais une “reconstitution parfaite”, mais une renaissance plausible, un pont entre l’histoire réelle et la fascination moderne pour les mondes anciens.
Aujourd’hui, quand un tambour résonne sur scène ou qu’une talharpa gémit sous l’archet, ce n’est pas seulement un spectacle. C’est la continuation de mille ans de transmission, de silence, de redécouvertes. Une manière de faire revivre ce que les Vikings ont peut-être entendu : une musique libre, tellurique, enracinée dans la voix humaine et les éléments.
Conclusion : un héritage sonore qui continue de vibrer
La musique viking n’a pas traversé les siècles intacte, mais ses échos demeurent. Entre fragments archéologiques, traditions nordiques et reconstitutions modernes, un paysage sonore cohérent se dessine : voix puissantes, instruments à musique simples, rythmes telluriques et chants venus du fond des fjords.
Aujourd’hui, grâce aux chercheurs, artisans et musiciens, ces sons reprennent vie. Ils ne reproduisent pas exactement la musique des Vikings, mais ils en ravivent l’esprit : brut, vibrant et profondément humain.
Et maintenant, à vous ! Partagez votre avis en commentaire : quel chant ou instrument viking vous intrigue le plus ?
Vous pouvez aussi poursuivre votre voyage nordique en explorant nos autres articles du blog.

























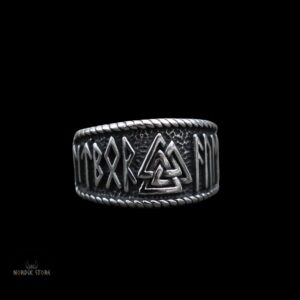







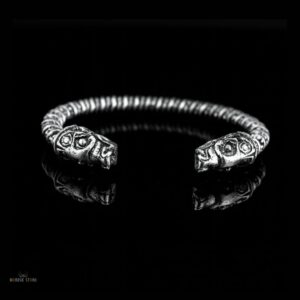









0 commentaires